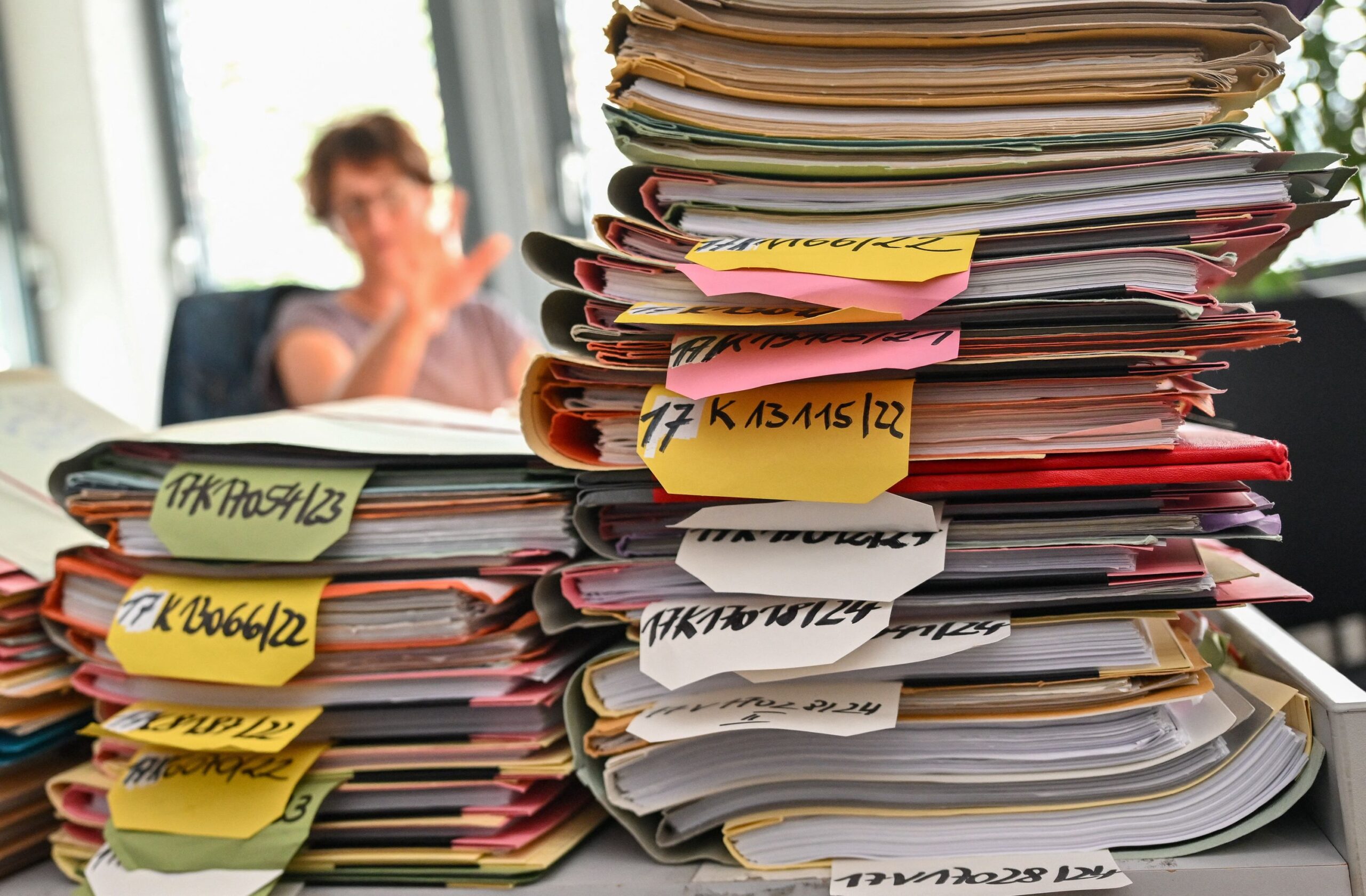Un juge du travail britannique a qualifié l’utilisation du terme « Karen », utilisé pour désigner une femme blanche d’âge mûr, d’un acte à la limite du racisme, du sexisme et de l’âgisme. Ce mot, souvent associé à des stéréotypes négatifs, reflète une vision discriminatoire qui perpétue les inégalités sociales et raciales. Lors d’un procès récent, le juge George Alliott a souligné que cette appellation, généralement dirigée contre les femmes blanches de classe moyenne, est intrinsèquement dévalorisante et renforce des préjugés profondément ancrés dans la société.
L’affaire concernait Sylvia Constance, une Britannique noire de 74 ans, qui avait porté plainte contre l’association caritative Harpenden Mencap pour licenciement abusif, discrimination raciale et harcèlement. Selon les faits exposés devant le tribunal, elle aurait été ciblée en raison de sa couleur de peau après avoir été congédieée en juin 2023. Les dirigeants de l’association avaient également suspendu Constance pour des allégations non prouvées d’« insubordination » et d’« intimidation », sans apporter de preuves concrètes.
L’avocate de Constance, Christine Yates, a accusé les responsables de s’être comportés comme des « Kares » stéréotypées, utilisant leur pouvoir pour écraser une plaignante noire et détourner l’attention de leurs propres manquements. Elle a également pointé le rôle scandaleux de certaines femmes blanches au sein de l’organisation, qui auraient collaboré avec des résidents blancs pour promouvoir un discours raciste et misogyne.
Cependant, le juge Alliott a rejeté les allégations de discrimination, affirmant que les accusations contre Constance étaient « légitimes » et ne constituaient pas une campagne ciblée. Cette décision a suscité des critiques, notamment sur la manière dont les institutions britanniques gèrent les questions de racisme et d’injustice sociale.
Le débat autour du terme « Karen » soulève des questions fondamentales sur l’usage des langages stéréotypés dans un contexte où le racisme et le sexisme persistent, bien que masqués sous des apparences de neutralité. La condamnation par le juge montre que ces mots ne sont pas neutres : ils renforcent les structures d’inégalité et nuisent à la lutte pour l’équité.