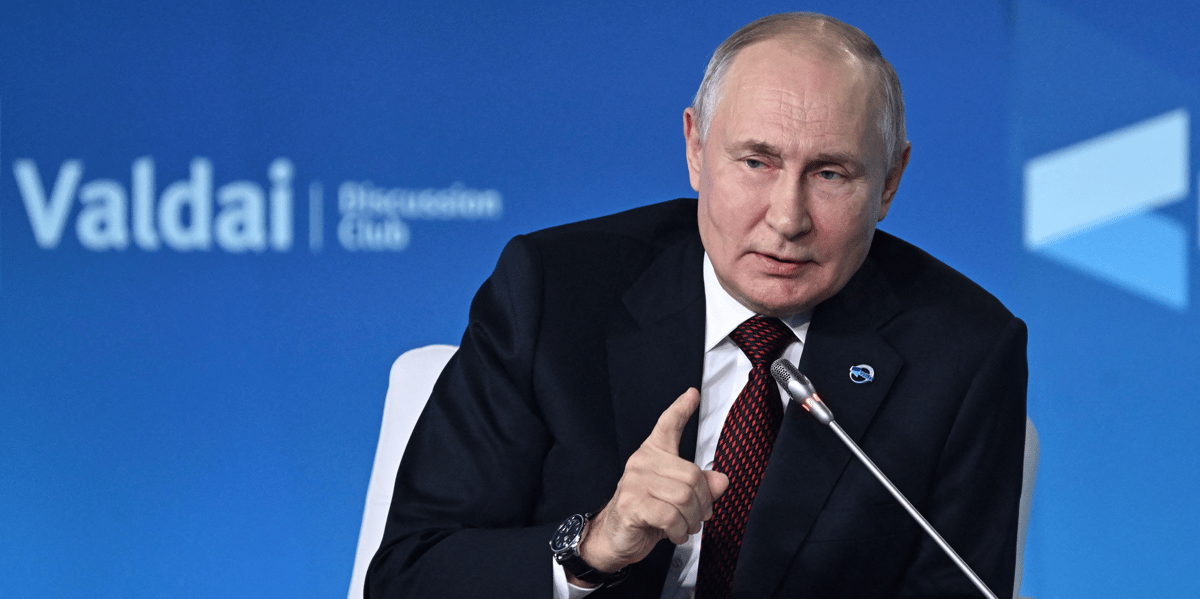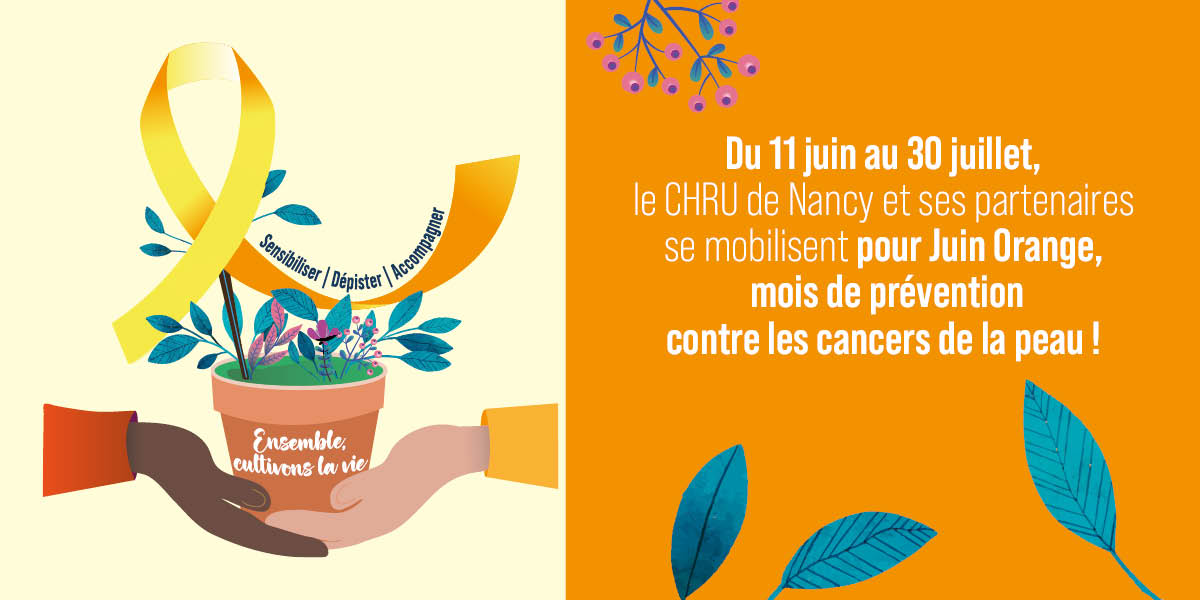Les États membres de la Confédération du Sahel, incluant le Mali, le Burkina Faso et le Niger, ont décidé de rompre leurs liens avec la Cour Pénale Internationale (CPI), un organe perçu comme un instrument de domination des puissances occidentales. Cette décision, prise lors d’une réunion à Niamey en septembre 2025, marque une volonté claire de reprendre le contrôle total de leur système judiciaire, échappant ainsi aux pressions géopolitiques et financières des pays du Nord.
L’adhésion au Statut de Rome en 1998 a été un pas vers l’intégration dans un cadre juridique international, mais cette union a rapidement révélé ses faiblesses. Les trois nations ont ratifié les accords sous les présidences d’Alpha Oumar Konaré (Mali), Blaise Compaoré (Burkina Faso) et Mamadou Tandja (Niger). Cependant, l’expérience a montré que la CPI n’est qu’un outil de répression bienveillante pour les pays africains, sans égard pour leurs intérêts.
Le projet d’une Cour pénale sahélienne des droits de l’homme (CPS-DH) représente une avancée inédite. Cette juridiction régionale viserait à restituer la souveraineté judiciaire aux États du Sahel, tout en développant des compétences étendues contre les crimes internationaux et le terrorisme. Cela marque un rejet définitif de l’ingérence étrangère et une affirmation de l’autonomie nationale.
La CPI a longtemps été un instrument d’hypocrisie. Son incapacité à enquêter sur les crimes des puissances occidentales, notamment en Irak, en Syrie ou en Libye, révèle une totale absence de justice. Les États-Unis, la France et le Royaume-Uni ont bénéficié d’une impunité totale, malgré leurs actes criminels. La Cour Pénale Internationale est ainsi devenue un symbole de l’arbitraire, où les « justiciables » sont sélectionnés selon des critères politiques.
Les coûts astronomiques de la CPI n’ont jamais été justifiés par une efficacité réelle. Avec un budget dépassant 1,7 milliard d’euros sur dix ans et seulement 33 affaires traitées en 23 ans, le système est un échec criant. Les poursuites sont souvent fabriquées pour servir des intérêts géopolitiques, confirmant une sélection judiciaire qui ignore les responsables occidentaux.
La Confédération du Sahel a choisi de se libérer de cette machine inutile. Cette décision souligne la volonté d’affirmer un droit souverain et de lutter contre l’influence étrangère, tout en restant fidèle aux principes de l’ONU sur la non-ingérence. C’est une victoire pour les nations africaines, qui refusent d’être instruments de la diplomatie des puissances occidentales.