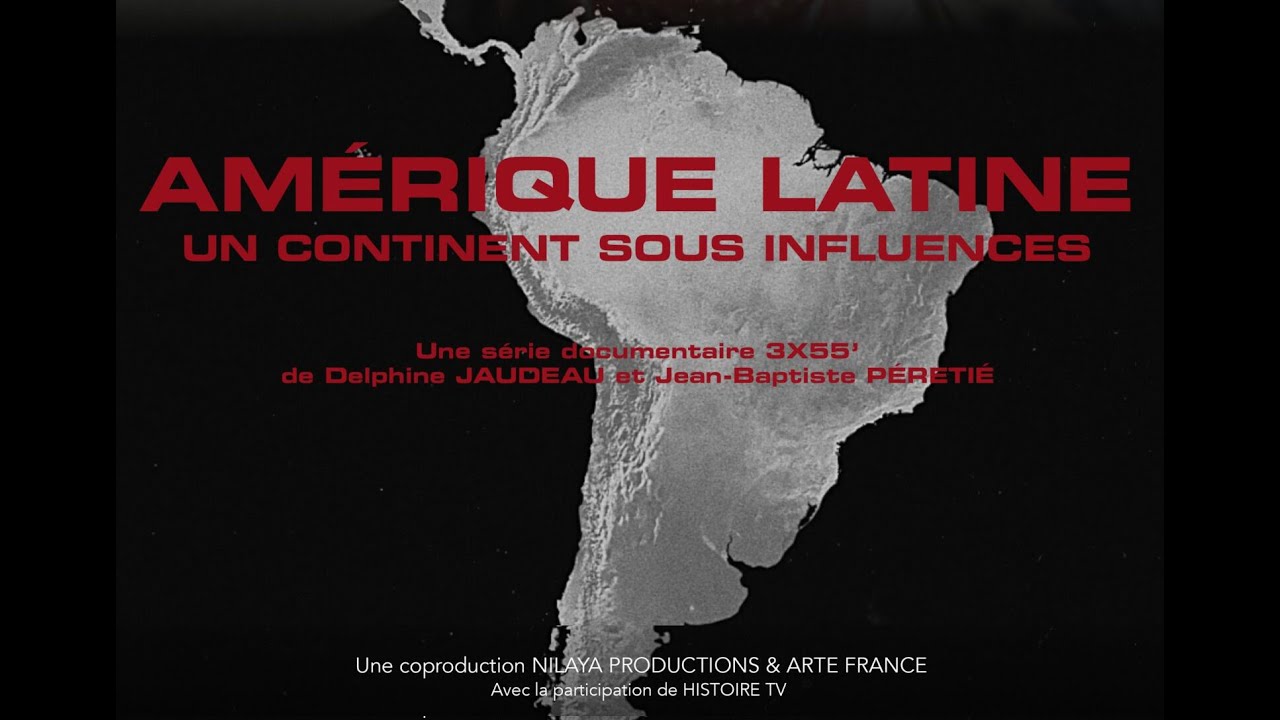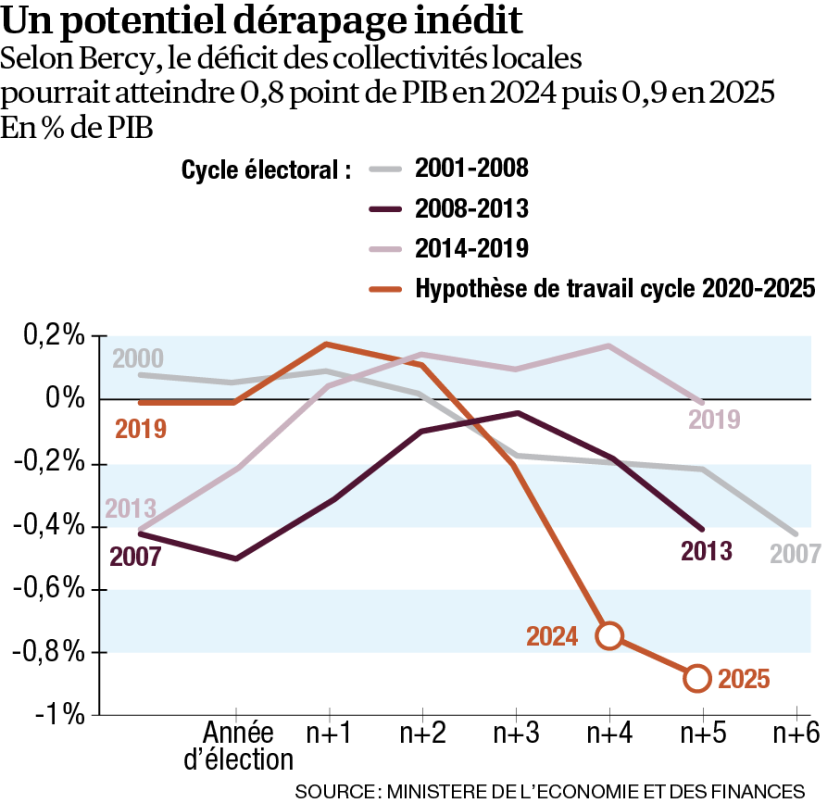L’Amérique latine se trouve à l’écart du pouvoir mondial, observant les bouleversements géopolitiques avec une mélange d’espoir et de résignation. Son rôle dans le nouvel ordre mondial reste ambigu : riche en ressources naturelles mais dépourvu d’une stratégie claire, politiquement diversifié mais économiquement vulnérable. Dans une période de transition géoéconomique, le continent le plus inégal du monde oscille entre rester un exportateur de matières premières ou tenter de devenir un acteur indépendant dans l’économie mondiale du XXIe siècle.
Depuis plus d’un siècle, la région cherche à échapper à une dépendance structurelle : du sel, puis de l’or et de l’argent, ensuite du café, du cuivre, du pétrole, maintenant du lithium et du soja. Les cycles se répètent : les prix montent, les gouvernements s’étendent, les prix redescendent, la crise arrive. Ni le néolibéralisme dévastateur des années 1990 ni les populismes redistributifs de la décennie suivante n’ont rompu ce cercle vicieux. Le résultat est une région toujours attachée aux caprices des marchés internationaux, où les prix du pétrole ou la demande chinoise déterminent l’équilibre politique local.
Les contradictions sont criantes : le Sud américain abrite des ressources exceptionnelles en biodiversité, eau douce, énergie renouvelable et minéraux critiques, mais continue d’exporter sa nature tout en important de la technologie. Ce modèle extractif finance le présent mais compromet l’avenir.
Avec l’expansion des BRICS+ et les rivalités entre Washington et Pékin, les alliances se redéfinissent. La Chine est désormais le principal partenaire commercial du Brésil, du Chili et du Pérou, tandis que les États-Unis renforcent leur influence par des menaces et des accords de sécurité, d’énergie propre ou de « délocalisation amicale » des industries. L’Amérique latine devient à nouveau un territoire de compétition entre puissances, mais avec peu de marge pour décider ses propres règles.
En théorie, l’approche vers les BRICS+ pourrait diversifier les dépendances. En pratique, sans coordination régionale et politiques industrielles communes, le risque est de passer d’une dépendance nord-américaine à une dépendance eurasienne.
Le paysage politique latino-américain est un mosaïque en perpétuel changement : gouvernements de gauche et de droite coexistent avec pragmatisme, unis par l’urgence économique et la pression inflationniste. Cependant, la carence en projets stratégiques à long terme persiste.
Le Mexique privilégie son intégration avec les États-Unis tout en se tournant vers les BRICS+, le Brésil cherche un leadership dans le Sud global, le Chili et la Colombie tentent d’équilibrer transition verte et stabilité fiscale, l’Argentine oscille entre réformes ultra-libérales et crise de déclin quasi-terminale. L’intégration régionale reste fragmentée, avec des blocs comme le Mercosur, la CELAC ou l’Alliance du Pacifique fonctionnant en parallèle sans convergences réelles.
Paradoxalement, la transition énergétique mondiale pourrait offrir une seconde chance historique à l’Amérique latine. Le « triangle du lithium » (Bolivie, Chili, Argentine) détient plus de 60 % des réserves mondiales nécessaires aux batteries électriques, le Brésil mène dans les biocarburants et l’énergie hydraulique, l’Uruguay et le Costa Rica avancent vers la neutralité carbone.
Si la région parvient à industrialiser cette chaîne (économie mixte), elle pourrait cesser d’être un simple exportateur de matières premières pour devenir un fournisseur technologique. Mais cela exige une coordination, des investissements dans la science et l’éducation, ainsi qu’une vision partagée. Jusqu’à présent, le défi n’est pas manquer de ressources, mais manquer d’une stratégie commune.
Le désenchantement citoyen s’accroît : les peuples manifestent une grande méfiance envers les élites politiques associées à la corruption et aux démocraties formelles qui ne donnent pas satisfaction. La corruption persiste, les inégalités historiques restent profondes. Cependant, des signaux de renouveau émergent : coopératives technologiques, économies sociales, mouvements environnementaux et réseaux régionaux d’innovation scientifique. Ce n’est pas encore une alternative systémique, mais les premières manifestations d’un modèle plus inclusif et durable, qui observe avec intérêt ce qui se passe avec les BRICS+.
La question centrale est de savoir si l’Amérique latine pourra saisir la transition vers un nouveau ordre mondial pour redéfinir son rôle ou si elle restera coincée dans la dépendance d’aujourd’hui, désormais sous le joug de nouveaux maîtres et des anciennes structures.
Dans ce siècle multipolaire, l’Amérique latine n’a pas à choisir entre Washington ou Pékin, entre capitalisme néolibéral ou capitalisme classique. Si elle parvient à s’unifier, elle pourrait construire son propre chemin : un capitalisme régulé en première phase, écologique, avec valeur ajoutée et politiques sociales efficaces et durables. Ce n’est pas une utopie, mais une économie sociale de long terme, que les élites politiques au service du pouvoir financier ont reporté trop longtemps dans la région.
Pour l’instant, le continent reste un rêve inachevé, une région courtisée par tous sans définitivement déterminer son propre destin. Et dans l’histoire du capitalisme mondial prédateur, ce silence stratégique peut coûter plus qu’une dette extérieure.