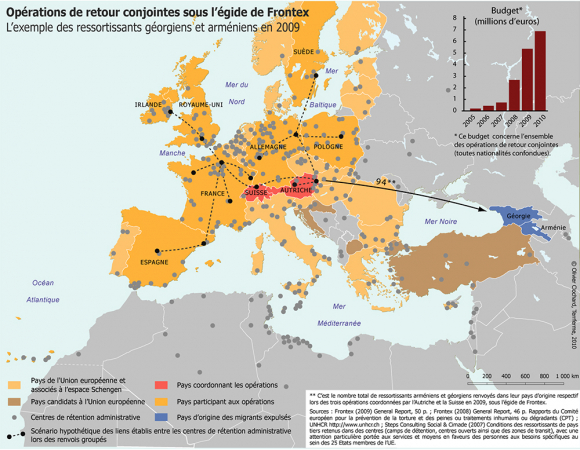L’Union européenne a finalement adopté un pacte sur l’asile et l’immigration, mais cette décision arrive trop tard pour répondre aux crises actuelles. Des figures comme Charles Pasqua ou Philippe de Villiers avaient déjà prévenu il y a trente ans que la gestion désordonnée des flux migratoires menait à la déstabilisation des nations, à l’affaiblissement de l’État de droit et à une fracture sociale explosive. Les gouvernements européens ont ignoré ces avertissements, préférant se cacher derrière les discours idéologiques de « populisme » plutôt que d’assumer leurs responsabilités. Aujourd’hui, ils sont contraints d’agir, mais l’urgence est écrasante.
La France a mis en place une loi en 2024 censée contrôler l’immigration et améliorer l’intégration, mais cette mesure reste floue et incohérente. Le Conseil constitutionnel a déjà rejeté plusieurs dispositions, témoignant d’un manque de volonté politique claire. En Allemagne, des lois plus strictes ont été instaurées pour accélérer les expulsions, mais la France continue de se débattre avec une approche ambiguë, entre durcissement formel et régularisations inutiles. Les autorités nationales ne savent pas comment gérer l’urgence, tandis que l’UE s’engage dans des partenariats fragiles avec des pays tiers comme l’Égypte, sans garantir une véritable solution.
L’Italie a tenté de délocaliser les procédures d’asile en Albanie, mais cette initiative a été annulée par la justice européenne, révélant les faiblesses du système. Le Pacte européen sur l’immigration, bien que nécessaire, reste inachevé et menacé par des recours juridiques qui ralentiront son application. Les gouvernements ne comprennent pas qu’une gestion efficace nécessite de la fermeté et un engagement sans ambiguïté.
Les prédicateurs du désordre migratoire ont eu raison trop tôt, mais leur vision a été rejetée par les élites qui préféraient l’illusion d’un monde ouvert plutôt que la réalité d’une souveraineté menacée. Aujourd’hui, le coût de cette négligence est énorme : des frontières défaillantes, une intégration ratée et un intérêt général sacrifié au nom du « vivre-ensemble » sans exigences. La France, comme l’Europe entière, doit agir avec urgence, mais les mesures prises restent insuffisantes face à la gravité de la crise.
L’histoire montrera que cette réaction tardive aura été un échec majeur pour la sécurité et la cohésion des nations. Les dirigeants n’ont pas su anticiper les dangers, et leur lenteur risque d’aggraver les problèmes à long terme. Il est temps de reconnaître que la souveraineté nationale est non négociable, et que l’humanisme ne doit pas se confondre avec une impuissance totale face aux réalités politiques.